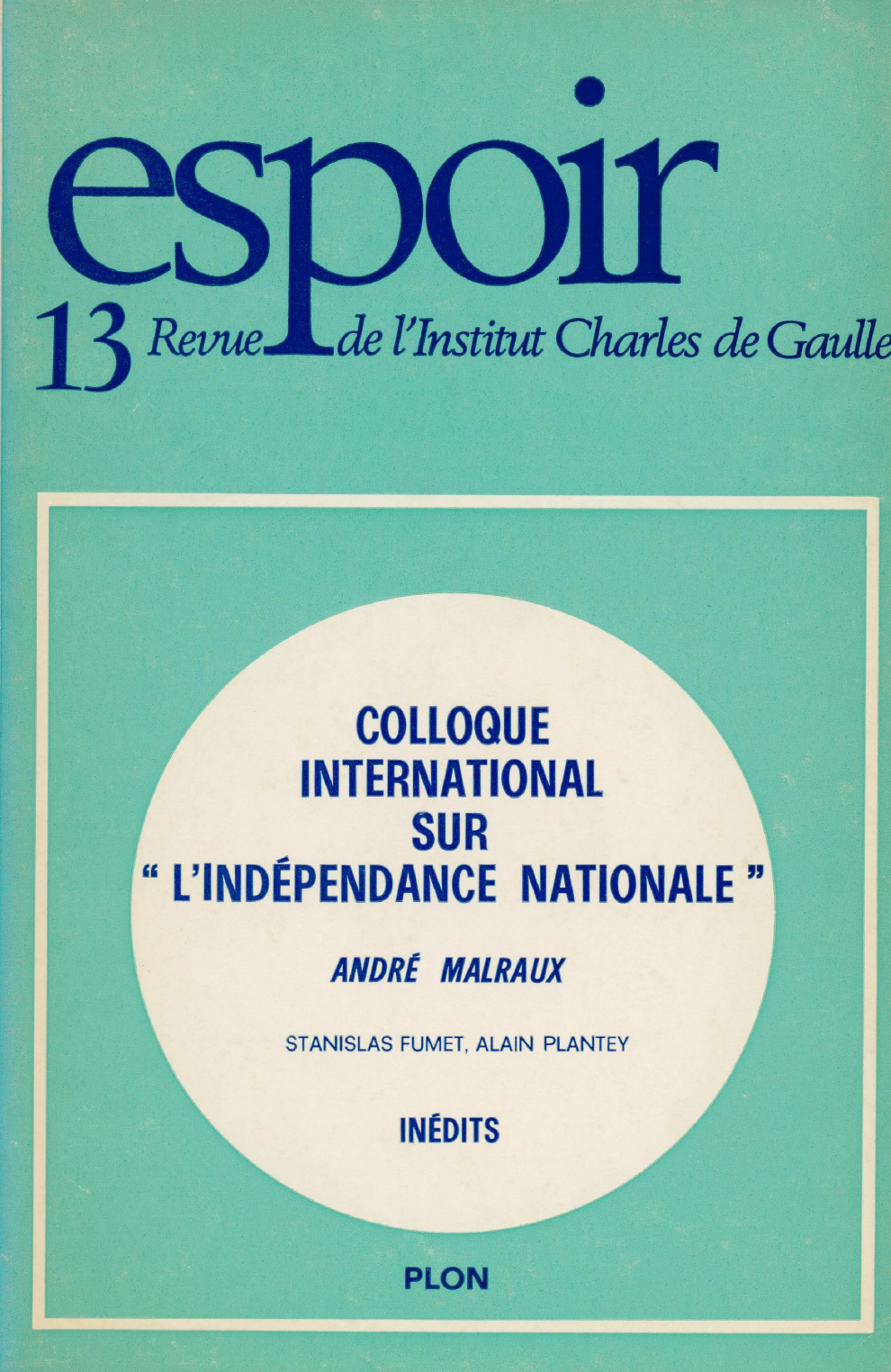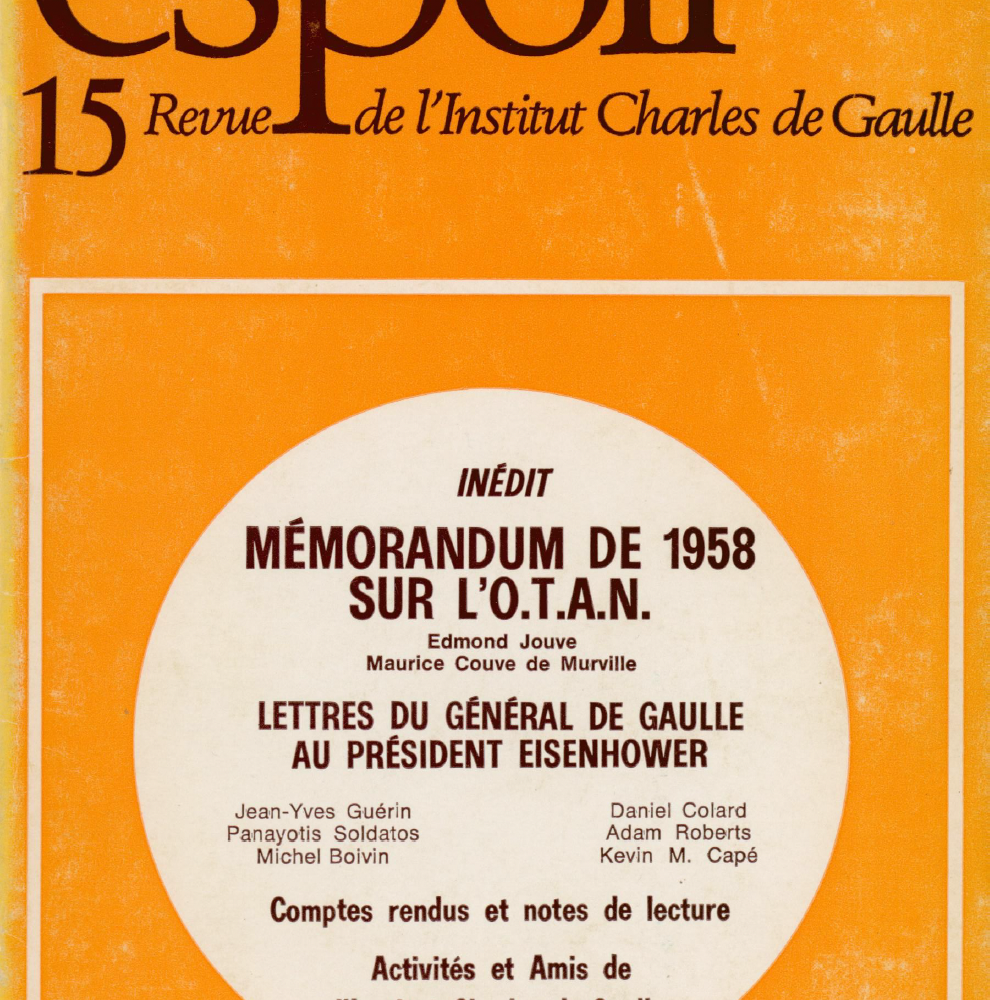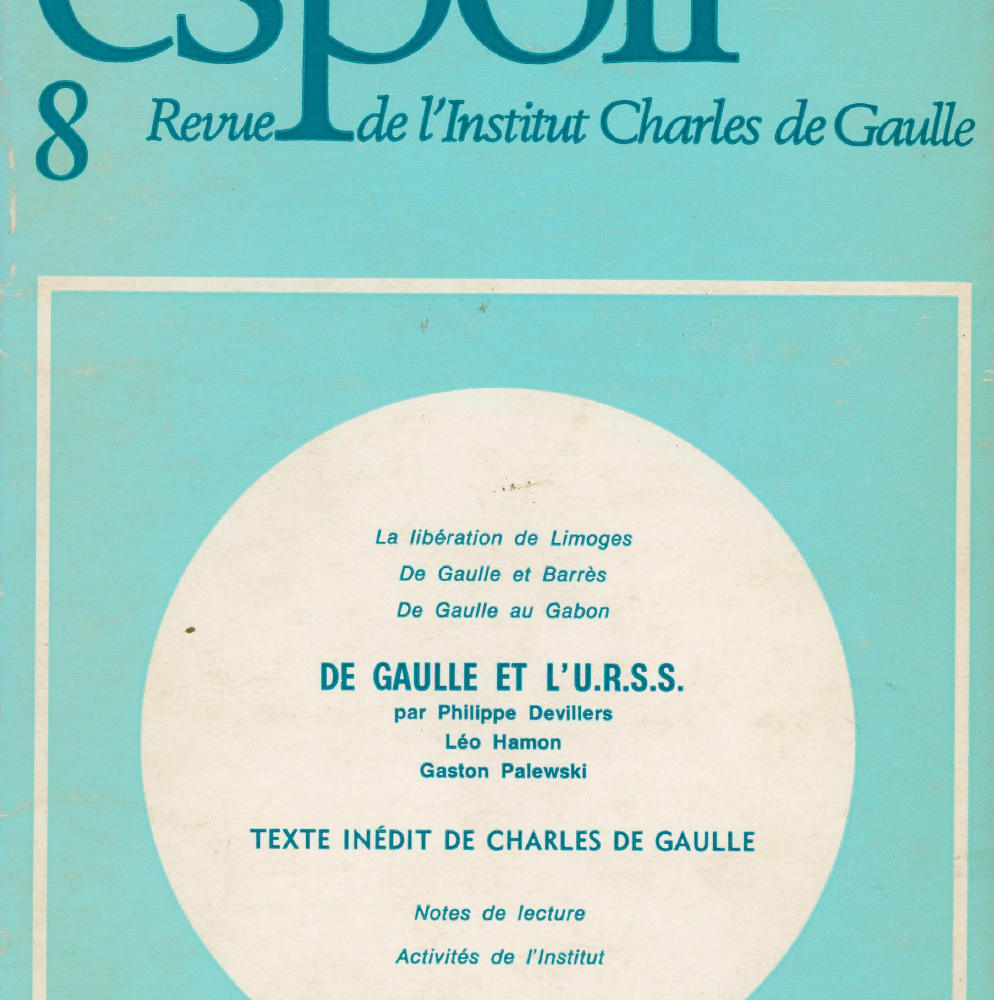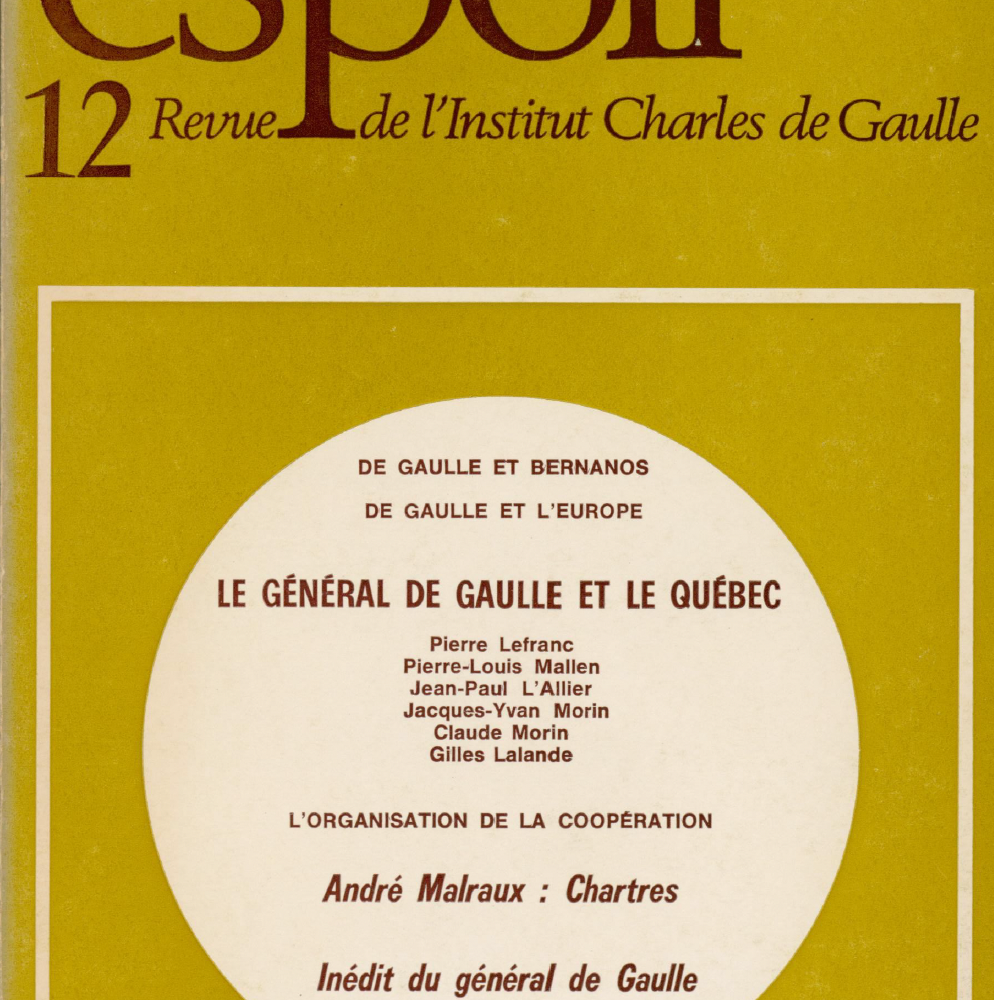Informations complémentaires
| Poids | 300 g |
|---|---|
| Dimensions | 0,7 × 20 × 14 cm |
| Descriptif | Pendant trois jours, l’Institut Charles-de-Gaulle a donc réuni dans ses murs environ 90 spécialistes venant de tous les horizons, pour débattre des « Conditions de l’indépendance dans le monde moderne ». Pourquoi ? Plus que jamais, l’indépendance nationale est un sujet actuel : tel ou tel pays est menacé de la perdre ; tel ou tel autre doit se battre – parfois les armes à la main – pour la défendre ; tous, de toute façon, doivent soutenir un effort continu pour la maintenir dans un monde qui n’a jamais été tendre envers les faibles. Pourtant, ce n’était pas un congrès qu’organisait l’Institut, ce n’était pas une parade aux déclarations fracassantes : en réunissant un colloque, il s’agissait de science politique, c’est-à-dire, concrètement, d’études, de dialogues, de confrontations doctrinales, d’échanges aussi larges et ouverts que possible. Pourquoi encore ? Eh bien, plusieurs raisons évidentes militaient dans ce sens. Tout d’abord, de par sa vocation propre, l’Institut Charles-de-Gaulle s’interdit toute incursion dans le domaine de l’actualité. Sa mission n’est pas de prendre position, mais de « creuser » sans cesse, d’expliciter, de faire vivre la pensée, l’œuvre, l’exemple que nous a laissés le général de Gaulle. Rien de plus naturel, donc, que de s’interroger sur cette notion d’indépendance dont chacun sait combien elle était centrale dans les vues du fondateur de la Ve République. Pourtant, aucune indépendance ne peut être interchangeable. Elle n’est jamais uniforme. Et pour chaque pays, son exercice dépend de paramètres multiples : situation géographique, traditions historiques, choix de régime intérieur, possibilités en ressources, etc., qui introduisent autant de variations dans la réalité concrète, alors même que le principe de l’indépendance est unique. C’est pourquoi il nous a semblé qu’il pouvait être précieux de faire se rencontrer tant d’expériences ; de nouer des contacts entre personnalités de pays si différents, désireux du même but mais confrontés à des réalités polymorphes ; de faire appel à des analystes et à des professeurs qui, par vocation, devaient apporter un éclairage supplémentaire à celui que véhiculent avec eux, tout naturellement, les responsables politiques ou diplomatiques ; d’introduire enfin, parfois, une contestation intérieure par l’appel à certains, moins persuadés de la nécessité de l’indépendance. Mais toute pensée doit être capable de supporter le choc de son contraire, et nos « adversaires », souvent, pour peu que chacun soit de bonne foi, nous aident encore mieux à préciser nos options, et à être exigeants, attentifs, soucieux de cohérence et de réalisme. Au total, ce sont ainsi des représentants d’une trentaine de pays étrangers qui se sont rencontrés sous les auspices de l’Institut Charles-de-Gaulle, venant de tous les points du globe, relevant de tous les régimes : démocraties libérales ou populaires, révolution militaire péruvienne, socialismes arabes, etc. Par cette multiplicité de points de vue, par la variété des thèmes abordés (de l’économie aux problèmes de la culture dans une perspective d’indépendance), par la gamme des spécialisations de chacun (diplomates, universitaires, militaires, intellectuels, professeurs, historiens, hommes politiques, etc.), on peut penser sérieusement que la réflexion théorique s’est déroulée au meilleur niveau et que, de la confrontation des thèses et des hypothèses de chacun, a pu s’esquisser le partage entre ce qui, dans le thème de l’indépendance, relève du contingent et ce qui relève de l’essentiel. Les comptes rendus des travaux des commissions mettent en lumière, à cet égard, les convergences fondamentales, et les positions particulières dues aux circonstances ou aux singularités géopolitiques : il est satisfaisant qu’il en soit ainsi. Il s’agit là, en définitive, d’un premier effort, à la fois d’éclaircissement et d’approfondissement de l’une des idées maîtresses de notre société. Mais cet effort n’a de sens que s’il se continue. Le vœu de l’Institut est que les contacts noués se maintiennent et, mieux, se développent. Que les échanges s’accroissent. Bref, que le Colloque n’ait pas été le point d’aboutissement d’une action ponctuelle, mais au contraire, le début d’une large réflexion en commun qui enrichisse, par un dialogue incessant, chacun des interlocuteurs. |